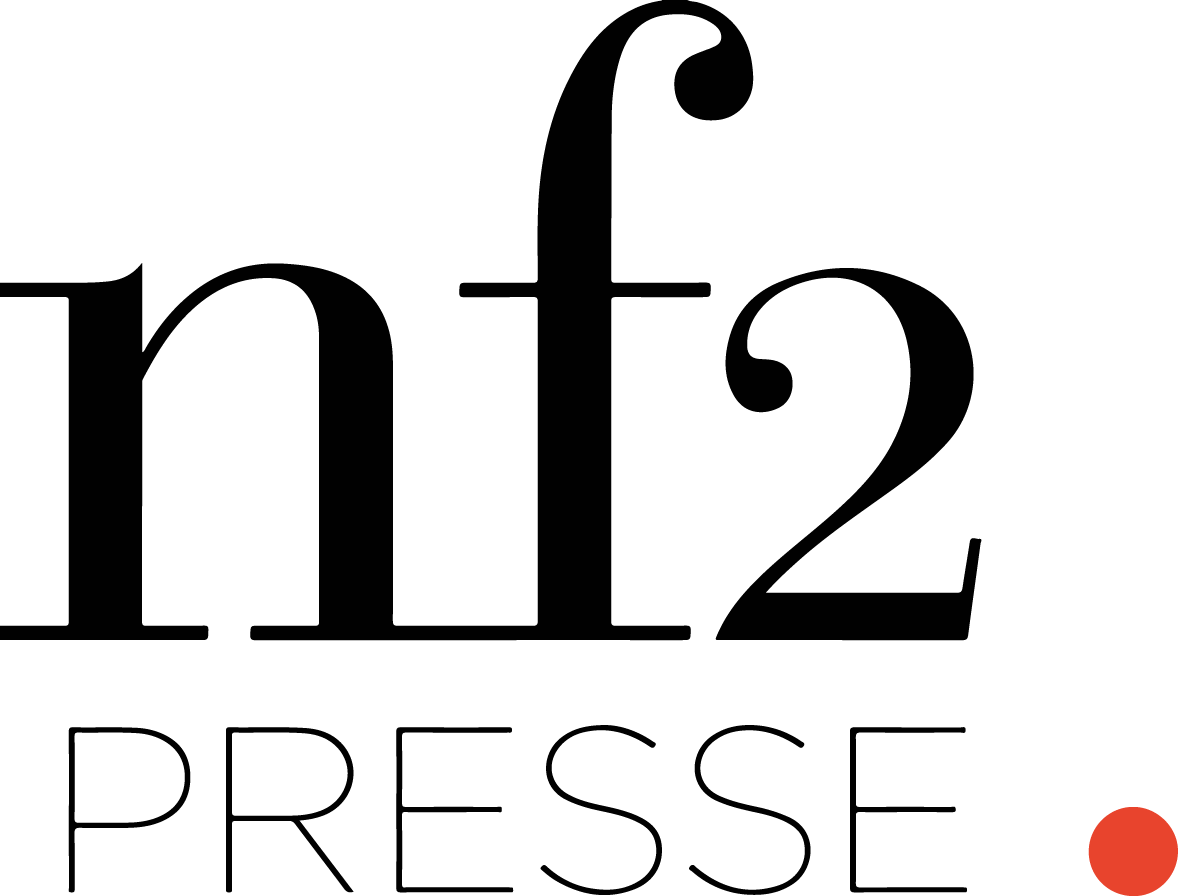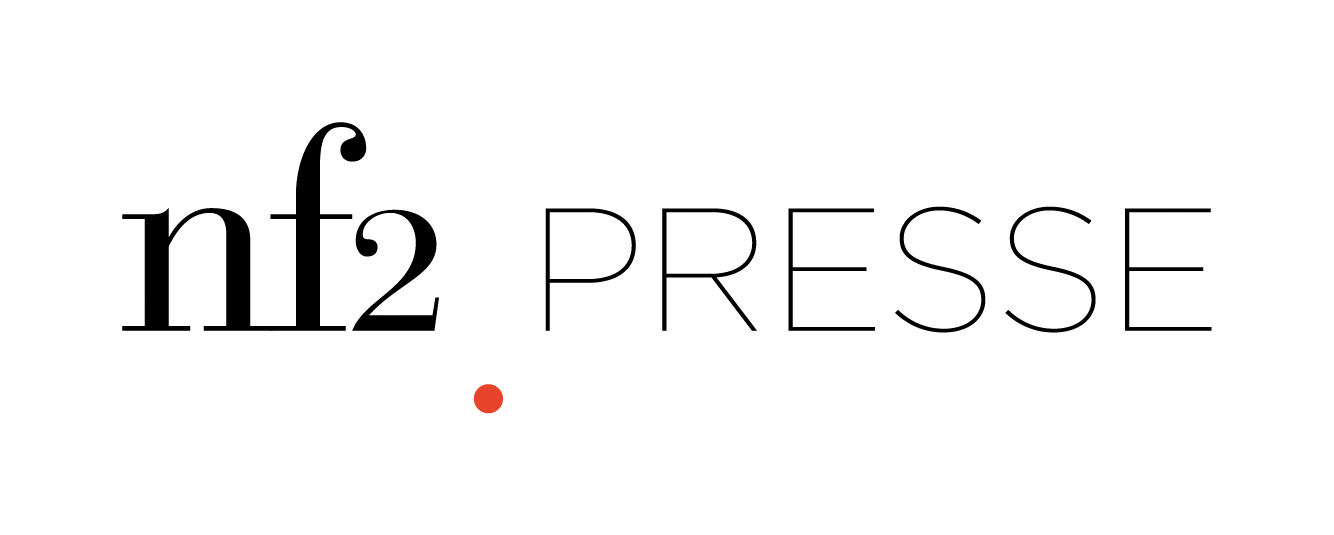Paru dans EGO#53 : Ça veut dire quoi manger bio ?
Ça veut dire quoi manger bio ? La question qui fait débat. Un article de fond paru dans le dernier numéro du magazine Egolarevue #53, rubrique Synthèse, signé Nancy Furer.
Le sujet semble rebattu tant l’agriculture biologique a pris sa part dans les assiettes – et les rayons de la grande distribution – depuis les années 80. Mais avec la crise inflationniste, celle-ci est malmenée. La multiplication des labels brouille les pistes et l’appétence du consommateur pour les produits locaux grignote sa toute-puissance. Faut-il dès lors continuer à faire confiance à la bio ? Éléments de réponse !

Officiellement née en France le 4 juillet 1980 par une timide notation dans la loi d’orientation agricole, la bio est d’abord définie comme une pratique « n’utilisant pas de produits chimiques ». Inscrite dans le contexte de l’après-68 et d’une crise pétrolière qui a souligné la dépendance de l’agriculture conventionnelle à l’énergie fossile, cette reconnaissance institutionnelle fait suite à l’activisme de quelques visionnaires, tels Nature et Progrès, qui rédige le premier cahier des charges bio français dès 1972, ou la Fédération nationale d’agriculture biologique des régions de France (Fnab), portée sur les fonts baptismaux en 1978.
En support, des consommateurs créent des groupements d’achats permettant de s’approvisionner en produits biologiques : Biocoop, par exemple, devenu le leader de la distribution bio spécialisée grâce à son réseau de plus de 750 magasins dans l’Hexagone. En 1991, le terme d’agriculture biologique apparaît dans un règlement européen reconnaissant officiellement ce mode de production. Celle-ci est enfin définie et reconnue dans toute l’Europe, facilitant les échanges et rassurant les consommateurs par l’harmonisation des mentions sur l’étiquetage via la marque AB.
La suite, on la connaît : l’agriculture bio passe progressivement d’une position marginale à une question centrale de société ; elle s’impose dans les esprits comme l’une des démarches les plus abouties pour la protection de l’environnement, de la biodiversité et de la santé humaine, ce qui lui confère un statut particulier et des bases solides. La grande distribution goûte à son potentiel business et inonde ses rayons de produits AB, dont les Français se révèlent gourmands. Petit à petit, la croissance du secteur se compte à 2 chiffres.
En 2019, les ventes de ces aliments labellisés AB frôlent les 12 milliards d’euros de chiffre d’affaires (11,9 milliards) selon l’Agence Bio, dont 55 % réalisés dans les grandes enseignes. Mais depuis 2020, le vent tourne ; les ventes baissent en raison de l’inflation, mais pas uniquement ! Si le facteur prix constitue un élément primordial, le problème serait plus profond : 54 % des Français estimeraient que les produits bio sont trop chers par rapport aux bénéfices qu’ils apportent. Beaucoup de consommateurs se plaignent par exemple d’une expérience cliente peu agréable, y compris sur les goûts… qui n’en seraient pas ! Payer plus cher pour un produit qui n’apporte pas plus de plaisir qu’un produit conventionnel passe difficilement. Le consommateur peine aussi à acheter en vrac et n’adhère pas toujours à l’ambiance des enseignes spécialisées, jugeant l’offre limitée, sa mise en scène réduite à la portion congrue et la pédagogie inexistante.
En contre-exemple parfait, Grand Frais joue les trouble-fête. Le taux de pénétration de l’enseigne alimentaire préférée des Français depuis plusieurs années a grimpé à un niveau record de 19,3 % en 2022, avec des produits issus de l’agriculture conventionnelle et une offre bio marginale, mais présentée de manière alléchante tout au long d’un parcours client libre et désirable.
Chez Naturalia, on riposte en axant la visibilité sur la double entrée « locale + bio ». Allon Zeitoun, son directeur général, entend porter la part des produits provenant d’un rayon de 150 kilomètres maximum des magasins de son réseau à 15 % d’ici deux ans, contre 6 à 10 % à l’heure actuelle selon les régions. « Notre stratégie repose désormais sur trois piliers : le bio, le local et le plaisir, argumente-t-il. Car la bio est la seule solution aux enjeux essentiels du secteur agroalimentaire ».
Discours similaire dans les rangs de Biocoop, mais avec un positionnement quelque peu différent. Le leader des spécialistes se veut plus militant et jusqu’au-boutiste que jamais. Confiante dans l’avenir d’une agriculture bio respectueuse des sols, de l’eau et de la biodiversité, la Coopérative a mis un coup d’accélérateur, ces dernières années, pour faire émerger des filières de production dans les territoires et ainsi pérenniser la vie des fermes françaises.
Elle leur redonne du pouvoir en partageant la valeur avec elles, en les impliquant dans ses décisions stratégiques et en les aidant à la transmission ou à la modernisation des outils de production. « Pour nous, l’agriculture bio ne peut être que paysanne, insiste Pierrick De Ronne, président de Biocoop. Elle doit combiner les enjeux environnementaux et sociétaux sous peine d’une inévitable dérive vers une agriculture biologique industrielle, qui ne respecte pas les sols, les animaux, les saisonnalités, les produits. Cette philosophie est toute entière contenue dans l’appellation « Avec nos paysan.ne.s associé.e.s », apposée sur notre offre des filières fruits et légumes, céréales, lait et viande produite par les 19 groupements de producteurs, soit 3 500 fermes 100 % bio, avec lesquels nous travaillons. Ces paysans associés sont le reflet de ce lien à la terre, que nous nous attachons constamment à renforcer ».
Biocoop est aussi vent debout contre l’émergence de ces labels poussés par le pouvoir politique, qu’elle considère comme de véritables mensonges pour le consommateur. Parmi eux, le macaron Haute valeur environnementale (HVE), d’ailleurs attaqué en début d’année devant le Conseil d’État par un collectif d’associations de consommateurs, d’agriculteurs et d’entreprises biologiques. « Nous le jugeons comme une dangereuse opération de greenwashing, car le recours aux intrants chimiques n’y est pas exclu, plaide Philippe Camburet, président de la Fnab. La justice doit arbitrer une bonne fois pour toutes ce débat et condamner cette tromperie ». Le monde de la recherche, lui, s’active en soute pour évaluer les bienfaits – ou pas – d’une alimentation bio.
Parmi les convaincus, Denis Lairon, nutritionniste et directeur de recherche émérite à l’Inserm, dont les travaux font référence. « L’agriculture biologique porte en elle une partie des solutions dont notre société a besoin, argumente-t-il. Alors que notre planète est accablée par la malnutrition d’un côté et le surpoids de l’autre, j’ai la conviction qu’il convient de la soutenir plus activement, tant pour sa capacité à nourrir les êtres humains, que pour des raisons de santé des populations, de protection de l’environnement et de paix sociale. Dans nos études, nous avons démontré que les consommateurs bio réguliers sont moins victimes de surpoids, de cancers, de diabète de type 2 ou de risque cardio-vasculaire. Pourquoi ? Surtout parce qu’ils sont moins exposés aux pesticides… ».
Un autre chiffre, tiré de l’étude BioNutriNet portant sur des milliers de participants, atteste que l’alimentation des adeptes du bio nécessite moins d’espace (un quart) qu’une alimentation conventionnelle, qu’elle émet moins de gaz à effet de serre (un tiers) et qu’elle mobilise moins d’énergie. Ce serait donc aussi ça, aujourd’hui, se nourrir bio !
Enquête signée Nancy Furer, à retrouver dans Ego la revue n°53.